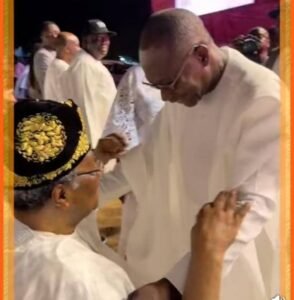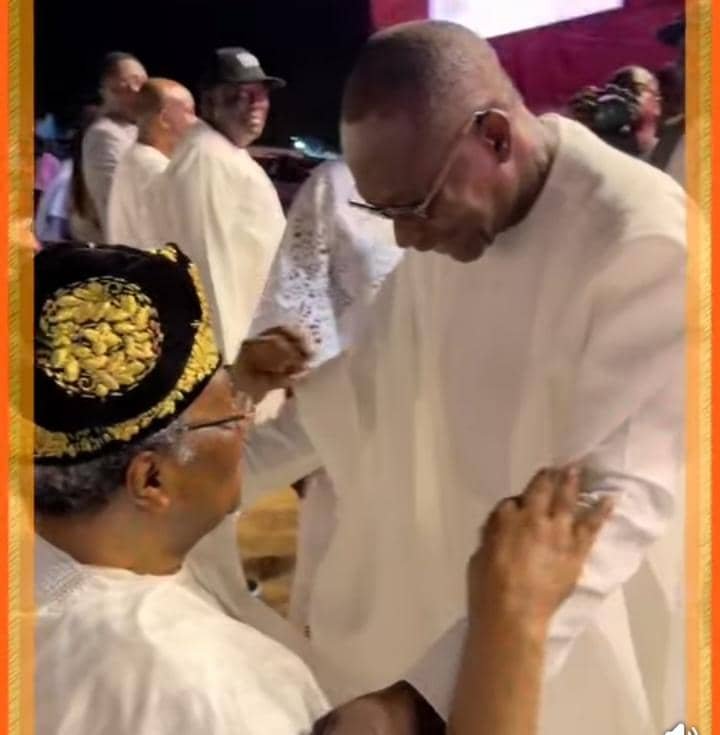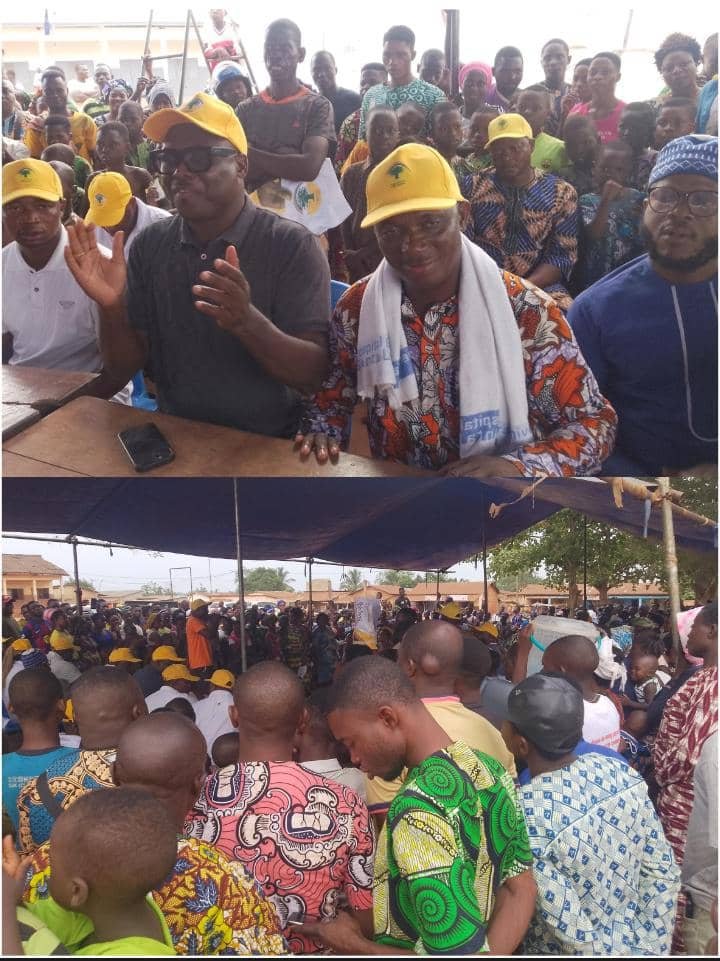Au Mali, le chef de la junte, le général Assimi Goïta, s’est vu octroyer un mandat présidentiel renouvelable indéfiniment et sans élection, à la suite de l’adoption, le jeudi 3 juillet, d’un projet de loi par le Conseil national de transition (CNT). Ce texte lui accorde officiellement un mandat de cinq ans, renouvelable « autant de fois que nécessaire », sans passer par les urnes.
La promulgation de cette loi par Goïta lui-même, actuelle formalité, actera son passage du statut de président de transition à celui de président de la République du Mali. Il s’agit là d’un tournant majeur dans la consolidation du pouvoir militaire dans ce pays sahélien, déjà marqué par une série de restrictions sévères aux libertés depuis la prise du pouvoir par les militaires.
Une loi votée à l’unanimité, une transition prolongée
Le projet de loi a été adopté à l’unanimité des 131 membres du CNT, bras législatif de la junte. Il stipule que la durée du mandat est de cinq ans, renouvelable jusqu’à la pacification du pays, à compter de sa promulgation. Le texte précise également que le président de la transition, les membres du gouvernement et ceux du CNT sont tous éligibles à la future élection présidentielle et aux élections générales, sans calendrier électoral défini.
Pour Malick Diaw, président du CNT, « il s’agit d’une avancée majeure dans la refondation du Mali », estimant que ce texte traduit la volonté populaire exprimée lors des assises nationales de la refondation.
Une promesse trahie et un avenir verrouillé
Les militaires, qui ont pris le pouvoir par deux coups d’État successifs en 2020 et 2021, s’étaient engagés à le rendre aux civils au plus tard en mars 2024. Cette nouvelle disposition éloigne toute perspective de retour à l’ordre constitutionnel avant au moins 2030, sans aucun processus électoral en vue.
Cette décision applique les recommandations issues d’une concertation nationale organisée fin avril par la junte, en l’absence de la plupart des partis politiques, qui ont boycotté le processus, dénonçant une mascarade visant à museler l’opposition.
Dissolution des partis et répression accrue
Les conclusions de cette concertation préconisaient notamment la dissolution des partis politiques et la limitation drastique des libertés d’association et d’expression. Peu après, la junte a mis ces recommandations à exécution en dissolvant les partis et organisations à caractère politique, et en interdisant à leurs membres de se réunir.
Le 3 mai à Bamako, lors d’un rare rassemblement autorisé et très encadré par la police, plusieurs partis politiques avaient déjà dénoncé l’intention du régime de les faire disparaître, à l’image du Niger et du Burkina Faso voisins, également sous contrôle de régimes militaires.
Une logique régionale assumée
Comme ses voisins sahéliens, le Mali est confronté depuis 2012 à une insécurité chronique, marquée par les attaques jihadistes d’organisations affiliées à Al-Qaïda et à l’État islamique, ainsi que par des conflits intercommunautaires.
L’armée malienne, appuyée par les mercenaires russes d’Africa Corps, est régulièrement accusée d’exactions contre les civils dans le cadre de ses opérations anti-jihadistes.
Face à cette situation, le Mali s’est rapproché du Burkina Faso et du Niger, formant ensemble l’Alliance des États du Sahel (AES), une confédération souverainiste qui a rompu avec les anciens partenaires occidentaux, notamment la France et l’Union européenne.
Dans cette logique, le Burkina Faso a également prolongé de cinq ans sa transition militaire sous le capitaine Ibrahim Traoré, tandis que le Niger, sous le général Abdourahamane Tiani, a établi un mandat de cinq ans sans élection après avoir renversé le président élu Mohamed Bazoum.
Avec cette nouvelle loi, le Mali s’inscrit désormais pleinement dans cette dynamique de maintien au pouvoir par la force, sans contre-pouvoir ni pluralisme politique, au nom de la souveraineté et de la stabilité.